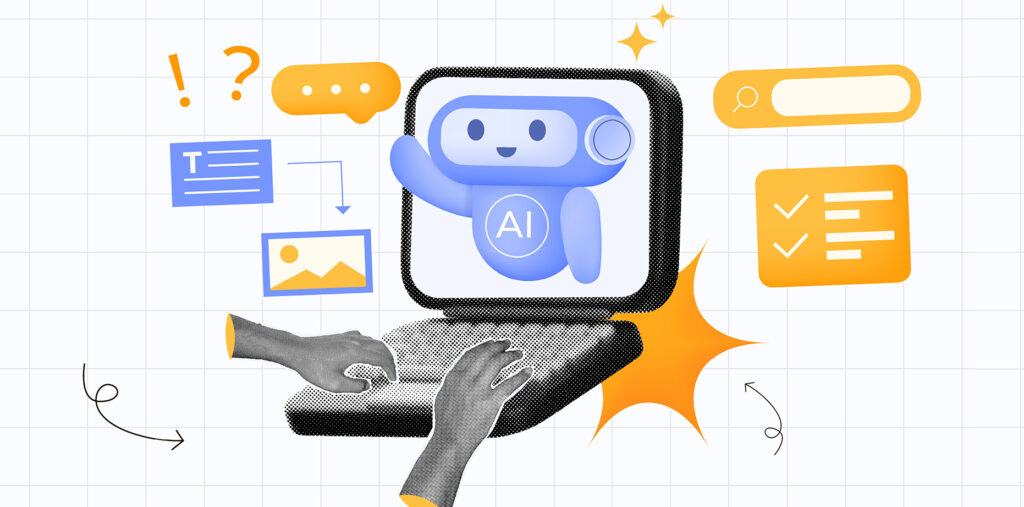La complexité de l’intégration de l’intelligence artificielle dans les organisations : entre incertitude et transformation
- Impact incertain des IA génératives : près de la moitié des actifs et étudiants interrogés ne parviennent pas à estimer la part de leurs tâches réalisables par ces outils, signe d’une appropriation limitée et d’une méconnaissance généralisée (Ifop, 2023).
- Dualité de l’incertitude organisationnelle : l’automatisation de tâches routinières apporte une réduction locale de l’incertitude, tandis que l’intégration des IA à l’échelle de l’entreprise amplifie l’incertitude globale via l’ignorance des acteurs, l’indétermination pratique, la nouveauté agentique et la récursivité concurrentielle.
- Approche systémique requise : dépasser la focalisation sur des cas d’usage isolés en adoptant un cadre sociomatériel reposant sur la formation des équipes, l’ajustement des processus décisionnels et le maintien d’un dialogue ouvert entre tous.
L’émergence des intelligences artificielles génératives dans le monde professionnel soulève des questions majeures quant à leur impact sur le travail et l’organisation des entreprises. Lorsqu’on interroge les individus sur leur propre expérience professionnelle à travers le prisme de ces technologies, une forte incertitude apparaît quant aux transformations réelles induites par ces outils.
Un sondage réalisé par l’Ifop pour Taln illustre ce constat, en interrogeant 635 actifs et étudiants sur la proportion de leurs tâches quotidiennes potentiellement réalisables par des IA génératives (Ifop, 2023). Le résultat révèle qu’entre 49,1% et 56,9% des répondants ont opté pour la réponse « je ne sais pas », traduisant ainsi une incertitude omniprésente, indépendante des attitudes initiales – positives ou négatives – à l’égard de l’IA. Evidemment, si l’on peut dire que les résultats sont amenés à évoluer, cela se fera progressivement et il est aujourd’hui difficile d’en supposer la directionnalité.
Quelle est la part des tâches réalisées dans votre quotidien de travail qui pourraient être effectuées par des IA génératives selon vous ?
Voici les résultats du sous-échantillon actifs et étudiants, soit 63% de 1008.
| Aucune | 9 | 6,8 | 11,2 | 2,2 |
| Entre 1 et 10% | 13 | 10,4 | 15,6 | 2,6 |
| Entre 11 et 20% | 8 | 5,9 | 10,1 | 2,1 |
| Entre 21 et 30% | 4 | 2,5 | 5,5 | 1,5 |
| Plus de 30% | 13 | 10,4 | 15,6 | 2,6 |
| Vous ne savez pas | 53 | 49,1 | 56,9 | 3,9 |
Ce constat empirique, loin d’être anecdotique, interroge la capacité des organisations à anticiper et intégrer de manière structurée ces technologies. Paradoxalement, si l’IA peut réduire l’incertitude dans l’exécution de tâches précises (par exemple, en automatisant un processus routinier ou en fournissant des prédictions sur des activités répétitives), son impact à un niveau organisationnel plus global se révèle ambigu et générateur de nouvelles incertitudes. L’enjeu n’est donc pas uniquement de mesurer l’impact immédiat de l’IA sur des processus existants, mais de comprendre les mécanismes sous-jacents qui conditionnent sa transformation des pratiques et des structures organisationnelles.
Dans ce contexte, le présent texte se propose d’examiner les dimensions de l’incertitude organisationnelle associée à l’intégration des IA génératives. Il s’articule autour de plusieurs axes : la présentation des données empiriques, l’analyse théorique de l’incertitude de Knight et son application au contexte des organisations, l’identification de quatre composantes majeures de cette incertitude, la critique de la quête des cas d’usage comme stratégie de réduction de l’incertitude, et enfin, la réflexion sur la notion de sociomatérialité qui souligne l’intégration réciproque entre technologie et structure organisationnelle.
Contexte empirique et état de l’art
L’analyse des données issues du sondage de l’Ifop pour Talan met en exergue une difficulté majeure : l’incapacité pour une large frange de la population active à évaluer avec certitude l’impact potentiel des IA génératives sur leurs tâches quotidiennes. Ce résultat, qui montre une prédominance du « je ne sais pas » chez près de la moitié des répondants, s’explique par plusieurs facteurs.
Premièrement, l’expérience concrète avec les IA génératives demeure limitée au sein des catégories socio-professionnelles. Environ 80% des individus interrogés n’utilisent pas ces outils dans leur quotidien professionnel, et leur utilisation est surtout concentrée dans des environnements hautement qualifiés, à revenus élevés ou spécialisés dans le traitement de l’information. Même parmi ces populations, l’usage déclaré reste minoritaire, ce qui témoigne d’un décalage entre le potentiel théorique technologique des IA et leur appropriation effective par les organisations.
Deuxièmement, la question de l’impact de l’IA ne peut se réduire à l’évaluation immédiate d’une tâche isolée. L’intérêt croissant pour les cas d’usage – c’est-à-dire l’identification d’applications concrètes et sectorielles de l’IA – traduit une tentative de rendre palpable et mesurable l’impact de ces technologies. Toutefois, cette démarche, bien qu’elle offre un sentiment temporaire de contrôle, ne parvient pas à appréhender l’ensemble des processus de transformation à l’œuvre dans les organisations. Elle masque souvent la complexité structurelle et les dynamiques sous-jacentes qui caractérisent l’intégration des technologies émergentes.
L’incertitude organisationnelle face aux IA génératives
La difficulté à prédire l’impact des IA dans le milieu professionnel se rattache à une notion fondamentale en théorie du risque : l’incertitude de Knight. Selon cette théorie, certains risques ne peuvent être ni quantifiés ni réduits par la seule accumulation de données, car ils reposent sur des éléments partiellement irréductibles et intrinsèquement liés à la nature du futur. Dans le contexte de l’IA, l’incertitude de Knight se manifeste par l’impossibilité de mesurer précisément comment l’ensemble des technologies – et non un outil particulier – interagira avec les dynamiques organisationnelles.
En d’autres termes, si l’automatisation de tâches spécifiques peut, dans une optique réductrice, apparaître comme une source de certitude, l’ensemble des transformations engendrées par l’intégration de l’IA reste imprévisible à l’échelle organisationnelle. Cette dualité entre réduction locale de l’incertitude et amplification globale de celle-ci constitue un paradoxe majeur auquel sont confrontées les entreprises dans leur processus d’adaptation aux nouvelles technologies.
Les composantes de l’incertitude dans le cadre organisationnel
Pour mieux appréhender la nature complexe de cette incertitude, il est pertinent d’identifier plusieurs dimensions qui la composent (Townsend et al., 2024; Wu & Shang, 2020). Dans le cadre de l’intégration des IA génératives, nous pouvons distinguer quatre composantes interconnectées :
1. Ignorance des acteurs
Malgré la prolifération d’informations sur les outils d’IA disponibles, les décideurs et les acteurs organisationnels demeurent souvent incapables d’anticiper l’ensemble des possibilités futures offertes par ces technologies. Cette ignorance ne relève pas d’un manque de données, mais d’une limitation intrinsèque à la capacité humaine de saisir l’ensemble des interactions potentielles entre une multitude d’options technologiques et les spécificités de leur environnement organisationnel. Ainsi, l’accumulation de données n’aboutit pas à une connaissance exhaustive, car les besoins et les opportunités liés à l’IA évoluent de manière imprévisible. Les décideurs se retrouvent ainsi face à un champ d’incertitude quant à la pertinence des innovations qui émergent continuellement.
| Utilisez-vous des IA génératives ? | Très souvent | Assez souvent | De temps en temps | Jamais |
| Artisans et commerçants | 6 | 2 | 15 | 77 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 7 | 22 | 66 |
| Professions intermédiaires | 1 | 7 | 6 | 86 |
| Employés | 2 | 12 | 19 | 67 |
| Ouvriers | 0 | 18 | 23 | 59 |
2. Indétermination pratique
Le paysage technologique dans lequel s’inscrit l’IA est particulièrement dynamique et volatile. Des applications nouvelles voient régulièrement le jour, et des événements externes – qu’ils soient d’ordre sanitaire, géopolitique ou économique – peuvent modifier brusquement le cadre de référence initial. L’indétermination pratique se manifeste par la difficulté à prédire quelles fonctionnalités ou pratiques deviendront dominantes ou obsolètes dans un contexte en perpétuel changement (Singla et al., 2024). Ce caractère instable oblige les organisations à repenser continuellement leurs stratégies, rendant toute tentative de planification à long terme particulièrement hasardeuse.
3. Nouveauté agentique
L’IA, par sa capacité à générer des options inédites et à proposer des solutions qui échappent aux schémas traditionnels, introduit une dimension de nouveauté agentique. Cette caractéristique pose un double problème : d’une part, les technologies apportent des alternatives qui ne se conforment pas aux normes établies, et d’autre part, elles ne sont pas capables de saisir pleinement le sens et les subtilités des usages humains. Les innovations induites par l’IA restent souvent dépourvues de la contextualisation culturelle propre aux organisations. Cette absence de compréhension contextuelle renforce l’incertitude quant aux conséquences réelles des actions basées sur ces technologies, car les organisations doivent intégrer des éléments techniques qui ne se traduisent pas directement en valeurs ou en significations partagées.
4. Récursivité concurrentielle
Enfin, l’intégration des IA dans un environnement concurrentiel ajoute une couche supplémentaire d’incertitude par le biais de la récursivité concurrentielle. Les choix technologiques d’une organisation incitent souvent des réactions en chaîne : l’adoption d’une solution spécifique peut pousser les concurrents, partenaires ou même les régulateurs à adapter leurs stratégies, créant ainsi un cycle de rétroactions continu. Cette dynamique de réajustements stratégiques rend particulièrement complexe l’anticipation des impacts directs et indirects de l’IA sur l’organisation. Les interactions entre acteurs, chacune influençant la trajectoire de l’autre, témoignent d’un système en constante mutation où la prévisibilité demeure un idéal difficilement atteignable.
La quête des cas d’usage comme stratégie de réduction de l’incertitude
Face à ce contexte marqué par une incertitude généralisée, de nombreuses entreprises se tournent vers la recherche de « cas d’usage » spécifiques. L’idée est d’identifier une application concrète de l’IA dans un domaine particulier afin de réduire l’écart entre la promesse technologique et son impact réel. Ce recours à des exemples concrets permet de focaliser l’attention sur des tâches définies, offrant ainsi un sentiment de maîtrise et de contrôle, même s’il reste limité à une échelle réduite.
Pourtant, cette approche présente des limites notables. En se concentrant sur des cas d’usage isolés, on risque de masquer la complexité systémique inhérente à l’intégration de l’IA. Une focalisation excessive sur des exemples ponctuels tend à engendrer une accumulation de « petites certitudes » qui, loin d’apporter une vision globale cohérente, alimentent la persistance d’interrogations stratégiques et culturelles (Ameye et al., 2023). En d’autres termes, si l’on parvient à réduire l’incertitude au niveau d’une tâche spécifique, celle-ci se dilue dès que l’on remonte à l’échelle organisationnelle, où les interactions entre divers facteurs (technologiques, humains, concurrentiels) génèrent de nouvelles zones d’ombre.
L’approche par les cas d’usage, souvent inspirée par une tendance à imiter les stratégies d’acteurs jugés innovants sur le marché, offre ainsi un réconfort temporaire qui se heurte rapidement à la réalité d’un contexte en constante évolution. En effet, l’optimisme lié à l’application d’un cas d’usage réussi peut conduire à des attentes irréalistes quant aux potentialités de l’IA, tout en occultant la nécessité d’une réflexion plus structurelle et intégrée sur le long terme.
La sociomatérialité et l’intégration structurelle des technologies
Au cœur des débats sur l’intégration de l’IA dans les organisations se trouve la notion de sociomatérialité (Orlikowski, 2007). Ce concept théorique postule que la technologie ne peut être appréhendée uniquement comme un outil externe, mais qu’elle s’inscrit dans une dynamique réciproque avec la structure organisationnelle (Orlikowski, 2007). Autrement dit, les technologies influencent les pratiques et les structures des organisations, tout comme ces dernières façonnent l’usage qui en est fait.
L’intégration structurelle de l’IA implique que les outils technologiques interagissent avec les normes, les cultures et les dynamiques de pouvoir en place. Les pratiques quotidiennes d’utilisation, par exemple, participent à une reconfiguration progressive des modes d’organisation du travail, modifiant à la fois les rôles individuels et les processus collectifs. La sociomatérialité invite ainsi à dépasser une vision strictement technique de l’IA pour considérer ses implications sur la construction des savoirs, la redistribution des compétences et la redéfinition des identités professionnelles.
Cette approche holistique permet de comprendre pourquoi l’intégration des IA génératives reste marginale dans la plupart des organisations. La technologie, loin d’être adoptée de manière uniforme et prévisible, est le produit d’un assemblage complexe d’interactions sociales, économiques et culturelles (Volkoff & Strong, 2013). Ainsi, l’incertitude organisationnelle ne découle pas uniquement d’un manque de connaissance sur les potentialités des outils, mais également de l’incertitude inhérente aux processus de transformation sociale qui accompagnent leur déploiement.
Implications et perspectives pour les organisations
L’analyse détaillée des composantes de l’incertitude et de la dynamique d’intégration des IA génératives révèle plusieurs implications pour les organisations :
- Redéfinition des stratégies de gestion du risque : Face à une incertitude qui ne peut être entièrement mesurée, les entreprises doivent adopter des approches de gestion du risque flexibles et adaptatives. Plutôt que de chercher à éliminer l’incertitude par l’accumulation de données ou l’identification de cas d’usage isolés, il s’agira de construire des stratégies résilientes capables de s’ajuster aux évolutions imprévues du marché et des technologies.
- Réflexion sur la formation et l’apprentissage organisationnel : La transformation induite par l’IA implique un renouvellement des compétences et une redéfinition des savoirs mobilisés par les acteurs. Les organisations doivent donc investir dans des dispositifs de formation et dans la promotion d’un apprentissage continu afin de favoriser l’adaptation des équipes aux nouvelles réalités technologiques.
- Évolution des modes de décision : L’incertitude multiforme liée à l’intégration de l’IA appelle à repenser les processus décisionnels. Plutôt que de se baser exclusivement sur des indicateurs quantitatifs ou des prévisions linéaires, il est nécessaire d’adopter une approche intégrative qui tienne compte des dimensions culturelles, sociales et contextuelles. Cette démarche favorise une prise de décision plus collective et réflexive, intégrant les multiples points de vue des acteurs concernés.
- Importance du dialogue entre acteurs internes et externes : La récursivité concurrentielle souligne l’impact des interactions entre entreprises, régulateurs et partenaires sur la trajectoire d’intégration de l’IA. Un dialogue constant, fondé sur la transparence et l’échange d’expériences, peut permettre de réduire les incertitudes en partageant des bonnes pratiques et en anticipant collectivement les évolutions du marché.
- Vers une intégration plus structurelle et moins fragmentaire : Enfin, l’expérience actuelle montre que la recherche de solutions ponctuelles, bien qu’elle offre une forme de réassurance immédiate, ne constitue pas une réponse pérenne à la complexité des enjeux organisationnels. Les entreprises devront progressivement adopter des stratégies d’intégration qui ne se limitent pas à l’implémentation de cas d’usage, mais qui repensent en profondeur l’articulation entre technologie, culture organisationnelle et modes de travail.
Discussion : vers une nouvelle approche de l’incertitude technologique
La complexité inhérente à l’intégration des IA génératives révèle une dualité surprenante. D’un côté, ces technologies offrent des potentialités pour l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité ; de l’autre, elles suscitent une remise en cause des schémas traditionnels de gestion et d’organisation du travail. L’incertitude qui en découle n’est pas seulement liée à la méconnaissance des outils, mais s’inscrit dans un réseau d’interactions qui englobe des dimensions économiques, sociales et culturelles.
Dans ce cadre, l’incertitude organisationnelle apparaît comme un phénomène dynamique, évolutif et intrinsèquement lié à la transformation des pratiques professionnelles. Les entreprises se retrouvent ainsi face à un dilemme : comment concilier le potentiel de l’IA pour améliorer certaines tâches, tout en tenant compte de la complexité des interactions qui régissent l’organisation ? La réponse ne réside pas dans une simplification excessive des enjeux, mais dans la capacité à intégrer la multiplicité des facteurs en jeu.
Le recours aux cas d’usage, bien qu’utile dans une optique de démonstration de faisabilité, apparaît alors comme une stratégie réductrice. En focalisant l’attention sur des exemples isolés, on néglige la dimension systémique qui conditionne l’intégration des technologies à long terme. Ce phénomène, que l’on pourrait qualifier de « réduction de l’incertitude à l’échelle de la tâche », contraste avec la persistance d’une incertitude globale qui demeure liée aux interactions entre les différents niveaux d’analyse. Pour autant, l’illusion d’un contrôle accru par l’identification de cas d’usage ne doit pas occulter la nécessité d’une approche plus intégrée et réflexive.
L’analyse de l’incertitude organisationnelle face à l’IA met ainsi en lumière la nécessité d’un changement de paradigme dans la manière de concevoir la transformation numérique. Il s’agit de dépasser la vision technocentrée pour adopter une lecture qui intègre les dimensions sociales, culturelles et structurelles. Cette approche, fondée sur l’idée de sociomatérialité, propose de considérer la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme une composante intrinsèque d’un système en perpétuelle mutation.
EN CONCLUSION
L’intégration des intelligences artificielles génératives dans les organisations se révèle être un processus complexe, marqué par une incertitude multiforme et intrinsèque aux dynamiques de transformation. Les données empiriques, illustrées par le sondage de l’Ifop pour Taln, témoignent d’une incapacité générale à anticiper l’impact des IA sur le travail quotidien, révélant ainsi une méconnaissance des potentialités réelles de ces outils. Ce constat se double d’une analyse théorique inspirée de l’incertitude de Knight, laquelle distingue des risques mesurables de dimensions irréductibles qui se manifestent notamment par l’ignorance des acteurs, l’indétermination pratique, la nouveauté agentique et la récursivité concurrentielle.
La quête des cas d’usage apparaît alors comme une stratégie de réduction de l’incertitude, mais elle reste limitée par sa focalisation sur des applications isolées qui ne rendent pas compte de la complexité systémique des transformations organisationnelles. Par ailleurs, la notion de sociomatérialité invite à repenser l’intégration des technologies en tant que processus bidirectionnel, où la technologie et la structure organisationnelle se façonnent mutuellement. Dans ce cadre, il apparaît indispensable de développer des stratégies d’adaptation fondées sur une gestion flexible du risque, une révision des modes de formation et une évolution des processus décisionnels.
Ainsi, la transformation induite par l’IA ne peut être appréhendée de manière linéaire ou purement technique. Elle engage une réflexion profonde sur la manière dont les organisations structurent leur relation au changement, intègrent les innovations et réinventent leurs pratiques quotidiennes. L’incertitude, loin d’être un obstacle à éliminer, doit être comprise comme une dimension inhérente aux processus d’innovation et de transformation. Elle impose aux décideurs de cultiver une capacité d’adaptation et une vision systémique qui transcendent les simples applications technologiques.
En définitive, l’intégration des IA génératives dans le tissu organisationnel constitue un défi majeur, tant sur le plan technique qu’humain. Pour appréhender cette transformation, il est impératif d’adopter une approche holistique qui intègre l’ensemble des dimensions du changement – économique, social, culturel et stratégique. Seule une telle approche pourra permettre aux organisations de transformer l’incertitude en une opportunité d’innovation, en tirant parti des potentialités offertes par l’IA tout en anticipant et en maîtrisant les dynamiques complexes qui la traversent.
RÉFÉRENCES
Ameye, N., Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2023). How uncertainty shapes herding in the corporate use of artificial intelligence technology. Technovation, 127, 102846. https://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2023.102846
Ifop. (2023). Les Français et les IA génératives.
Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work. Organization Studies, 28(9), 1435–1448. https://doi.org/10.1177/0170840607081138
Singla, A., Sukharevsky, A., Yee, L., Chui, M., & Hall, B. (2024). The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value.
Townsend, D. M., Hunt, R. A., Rady, J., Manocha, P., & Jin, J. hyeong. (2024). Are the Futures Computable? Knightian Uncertainty and Artificial Intelligence. Academy of Management Review. https://doi.org/10.5465/AMR.2022.0237
Volkoff, O., & Strong, D. M. (2013). Critical Realism and Affordances: Theorizing IT-Associated Organizational Change Processes. MIS Quaterly, 37(3), 819–834.
Wu, J., & Shang, S. (2020). Managing Uncertainty in AI-Enabled Decision Making and Achieving Sustainability. Sustainability, 12(21), 1–17. https://doi.org/10.3390/SU12218758