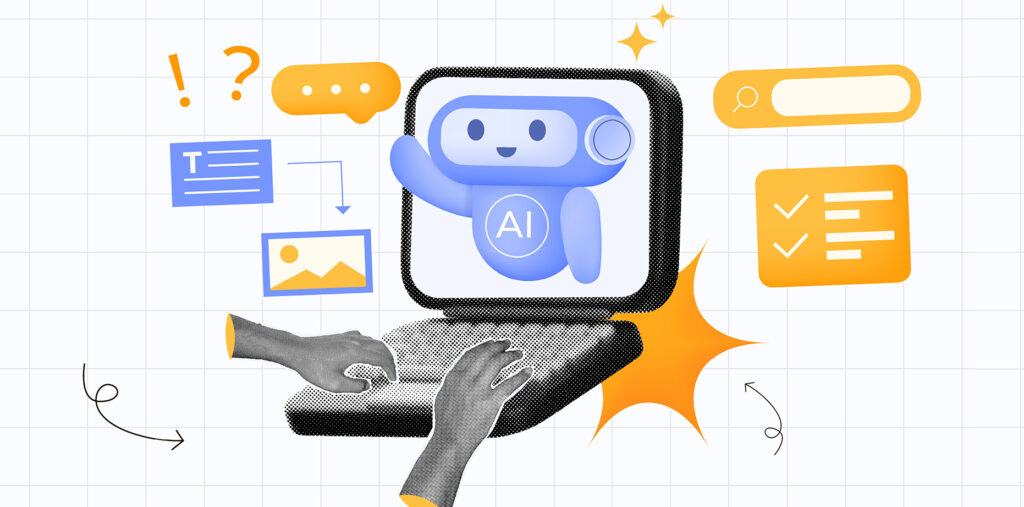Comment une politique RSE influence l’engagement des salariés ?
- L’attractivité employeur liée à la RSE semble dépendre moins de la présence d’engagements responsables que de leur capacité à entrer en résonance avec les valeurs différenciées des candidats, posant la question d’un positionnement RSE plus ciblé et segmenté.
- Plusieurs construits psychologiques – comme l’alignement individu-organisation, l’identification sociale ou la quête d’authenticité – apparaissent comme des leviers potentiels de mobilisation interne, mais leur intégration opérationnelle dans les politiques RSE reste encore marginale.
- L’incertitude sur les effets concrets de la RSE du point de vue salarié invite à développer des outils d’évaluation centrés sur l’expérience des individus et les écarts perçus entre valeurs affichées et pratiques vécues, afin de prévenir les dynamiques de dissonance et de retrait.
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) désigne l’intégration de préoccupations sociales et environnementales dans les activités et la stratégie d’une entreprise. Si la RSE est souvent abordée comme une démarche stratégique au niveau organisationnel, son succès dépend largement de l’adhésion qu’elle suscite chez les employés – à la fois de manière individuelle et collective. En effet, les salariés sont des parties prenantes internes importantes dont les valeurs, attitudes et comportements peuvent amplifier ou freiner l’impact d’une politique RSE. Comment la stratégie RSE d’une entreprise se traduit-elle concrètement par l’adhésion de ses employés ? Cette question mobilise plusieurs perspectives théoriques en psychologie sociale, notamment l’alignement des valeurs personnelles et organisationnelles, l’identification sociale, la motivation intrinsèque, ou encore la gestion de la dissonance cognitive.
De plus, l’adhésion à la RSE peut se jouer dès le processus de recrutement : l’image RSE de l’entreprise attire-t-elle des candidats partageant ses valeurs ? Une fois en poste, comment les salariés perçoivent-ils les actions RSE et y participent-ils ?
Facteurs et construits
Attentes préalables et choix de l’employeur
Avant même d’intégrer une entreprise, les individus forment des représentations de sa culture et de ses valeurs, notamment via sa réputation en matière de RSE. De nombreuses études montrent que la RSE influence l’attractivité de l’employeur aux yeux des candidats. Par exemple, une étude menée par Bustamante et al. (2020) auprès de 577 étudiants allemands en fin d’études montre que les engagements en matière de RSE influencent significativement l’attractivité perçue d’un employeur. Cette influence est particulièrement marquée chez les candidats dont les valeurs personnelles incluent l’altruisme et la sensibilité aux enjeux environnementaux. À l’inverse, pour les individus animés par des valeurs plus individualistes, les critères RSE jouent un rôle moindre dans le processus de choix d’un employeur. Ces résultats confirment que la RSE agit comme un levier d’attractivité différencié, en fonction des motivations et des profils de candidats, notamment parmi les jeunes générations.
Ces attentes initiales ne disparaissent pas une fois le contrat signé, et peuvent même se prolonger et se transformer au fil de l’expérience professionnelle. L’adéquation entre les valeurs personnelles des employés et les engagements RSE de leur entreprise devient alors un facteur déterminant dans la manière dont ces derniers interprètent, accueillent et soutiennent les démarches responsables de leur organisation.
Person-organisation fit
Le concept de Person–Organization fit a été défini dès 1996 comme la « compatibilité entre les individus et les organisations » (Kristof, 1996). Appliqué à la RSE, cet alignement entre les valeurs, les attentes et les comportements d’un individu et ceux de l’organisation à laquelle il appartient prend un relief particulier : il influence la façon dont les employés perçoivent les actions mises en œuvre, leur degré d’adhésion et la portée qu’ils accordent à l’identité responsable de leur entreprise.
Lorsque cet alignement est perçu comme fort, il favorise la satisfaction et la fidélité des employés (Subramani et al. 2022). Haski-Leventhal et ses collègues (2015) soulignent notamment que les salariés évaluent la RSE non seulement à travers les actions concrètes mises en place, mais aussi à travers la cohérence perçue entre les discours et les valeurs de l’organisation. De plus, si les recherches sur l’adéquation entre l’individu et l’organisation se sont longtemps concentrées sur les effets de cette adéquation sur les perceptions et comportements des salariés, l’engagement des employés est devenu un thème d’étude central. En effet, Memon et al. (2018) montrent que cette adéquation est un prédicteur direct de l’engagement des salariés, ce dernier étant lui-même associé à une moindre intention de quitter l’entreprise.
Théorie de l’identité sociale
Au-delà de l’alignement entre valeurs individuelles et organisationnelles, la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, 1979) permet de mieux comprendre pourquoi certains employés s’engagent pleinement dans les démarches RSE de leur entreprise. Selon ce cadre théorique, les individus construisent une partie de leur identité personnelle à partir de leur appartenance à des groupes valorisés – en l’occurrence, leur organisation. Une entreprise perçue comme responsable, sincère et engagée dans des causes sociétales offre ainsi aux salariés une opportunité d’identification positive. Lorsqu’ils se reconnaissent dans l’image que renvoie leur employeur, les employés ressentent une forme de fierté collective, qui renforce leur sentiment d’appartenance. Cette identification peut se traduire par une implication renforcée, mais aussi par des comportements volontaires allant au-delà des tâches prescrites, comme le mentorat, le bénévolat d’entreprise ou d’autres formes de contribution proactive au bien commun (Yassin & Beckmann, 2024). La RSE devient alors non seulement un vecteur d’adhésion individuelle, mais aussi un support de construction identitaire au sein du collectif de travail.
Motivation intrinsèque et extrinsèque
L’engagement des employés dans les démarches RSE dépend également de la nature de leur motivation, susceptible de varier fortement selon les individus. En psychologie, deux grandes formes de motivation sont distinguées : la motivation intrinsèque, fondée sur l’intérêt personnel, la conviction ou le plaisir d’agir, et la motivation extrinsèque, qui repose sur des récompenses ou contraintes externes (Deci & Ryan, 1985).
Appliquée à la RSE, cette distinction permet de comprendre pourquoi certains employés participent spontanément à des actions liées à la RSE, tandis que d’autres ne s’y engagent que lorsqu’ils en retirent un bénéfice concret (comme une reconnaissance managériale ou une évaluation positive). Une étude a introduit le concept d’ « autonomie relative spécifique à la RSE », soulignant que l’implication des employés est d’autant plus forte lorsqu’ils participent aux actions sociétales par conviction personnelle (Rupp et al., 2018). À l’inverse, lorsque la participation est motivée par des contraintes ou des récompenses externes, l’impact de la RSE sur l’engagement au travail reste limité. Pour être réellement mobilisatrice, la RSE doit donc entrer en résonance avec les valeurs individuelles des employés.
Authenticité au travail
L’authenticité au travail désigne la capacité d’un individu à exprimer son véritable soi dans son environnement professionnel, à agir en cohérence avec ses valeurs et convictions profondes. Les travaux de Glavas et al. (2016) montrent que la RSE peut renforcer le sentiment de sens au travail (meaningfulness) en permettant aux employés de mobiliser des aspects importants de leur identité personnelle dans le cadre professionnel. En offrant la possibilité d’agir en accord avec leurs valeurs — par exemple humanitaires ou écologiques —, l’entreprise favorise l’authenticité au travail. Ce sentiment d’authenticité s’avère être un moteur essentiel de l’engagement des salariés, bien plus puissant que les bénéfices matériels ou symboliques attendus de la RSE. En effet, lorsque les employés peuvent aligner leurs actions professionnelles avec leurs valeurs personnelles à travers des initiatives RSE, ils éprouvent un sentiment d’intégrité et de cohérence identitaire qui renforce leur bien-être psychologique et leur engagement organisationnel. Ce lien entre authenticité et engagement s’inscrit dans la continuité des mécanismes précédemment décrits : lorsque les valeurs personnelles trouvent un écho concret dans les pratiques de l’organisation (comme les actions RSE), cela renforce la compatibilité perçue entre l’individu et son environnement professionnel. L’authenticité agit ainsi comme une manifestation vécue du person-organization fit, en donnant aux employés l’occasion d’incarner pleinement leurs convictions dans leur travail quotidien.
Dissonance cognitive
La dissonance cognitive, concept central de la psychologie sociale introduit par Festinger (1957), désigne l’inconfort psychologique ressenti lorsqu’un individu est confronté à des croyances, des valeurs ou des attitudes contradictoires. Dans le contexte organisationnel et concernant les pratiques RSE, ce phénomène peut survenir lorsque les employés perçoivent un écart entre les engagements affichés par leur entreprise et les pratiques réellement observées.
Zhang et al. (2025) ont étudié la manière dont la dissonance cognitive émerge chez les salariés exposés à un décalage entre les valeurs RSE promues par leur organisation et les comportements effectivement observés au quotidien. Leurs résultats montrent que cette incohérence perçue peut engendrer de la méfiance, voire un cynisme à l’égard de l’entreprise, réduisant ainsi l’engagement des employés envers les démarches RSE. La dissonance cognitive se manifeste particulièrement lorsque les employés sont confrontés à des comportements organisationnels en contradiction avec les valeurs éthiques affichées. Par exemple, une entreprise mettant en avant son engagement environnemental tout en poursuivant des pratiques polluantes, ou valorisant officiellement l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle tout en encourageant implicitement la surcharge de travail, expose ses collaborateurs à la dissonance cognitive. Pour réduire cet inconfort, les individus cherchent généralement à restaurer une forme de cohérence, soit en révisant leurs croyances, soit en ajustant leur comportement. Dans un contexte organisationnel, cette tentative de régulation peut conduire à un retrait progressif : certains employés, ne parvenant pas à résoudre la contradiction perçue, développent une attitude cynique ou choisissent de se désengager, voire de quitter l’organisation.
Dans leur étude, Zhang et al. (2025) mettent en évidence un mécanisme particulièrement intéressant pour atténuer ces effets négatifs. En particulier, ils montrent que, lorsque les managers font preuve d’empathie et tentent de comprendre le point de vue de leurs subordonnés, ils créeraient un environnement psychologiquement plus sécurisant qui permettrait aux employés de mieux gérer les contradictions perçues. Cette approche managériale contribuerait donc à réduire le stress lié à la dissonance et favoriserait une résolution plus constructive des tensions éthiques au sein de l’organisation. Toutefois, il est important de souligner que, si elle peut atténuer les effets psychologiques de l’incohérence, la posture du manager ne saurait se substituer à une réelle mise en cohérence des pratiques organisationnelles avec les valeurs affichées.
Intégrer les construits psychologiques dans la mise en œuvre de la RSE
Les travaux présentés soulignent que l’efficacité d’une politique RSE repose en partie sur la manière dont elle résonne avec les construits psychologiques des employés, qu’il s’agisse de leurs valeurs personnelles, de leur besoin d’authenticité, ou encore de leur sensibilité à la cohérence entre leurs valeurs et les actions de l’organisation. Néanmoins, ces dimensions psychologiques semblent encore insuffisamment prises en compte dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de RSE. Ce constat invite à un double questionnement, à la fois d’ordre applicatif — concernant l’intégration de ces variables dans les pratiques managériales — et d’ordre théorique, en ce qui concerne leur modélisation et leur articulation avec les dispositifs organisationnels.
Sur le plan organisationnel, une première interrogation concerne la capacité des entreprises à diagnostiquer et anticiper les effets psychologiques des politiques RSE. Comment s’assurer que les actions mises en place sont perçues comme étant alignées avec les engagements proclamés ? Peut-on développer des outils permettant de mesurer régulièrement l’alignement perçu entre valeurs personnelles et pratiques organisationnelles (e.g., échelles de congruence valeur–organisation, indicateurs de dissonance perçue) ? L’analyse de ces écarts permettrait d’identifier les zones de vulnérabilité et d’agir en conséquence pour l’organisation, et tenter d’anticiper d’éventuelles conséquences évoquées pour résoudre l’état de dissonance cognitive.
Une deuxième série de questions concerne la différenciation des profils d’engagement face à la RSE. Les résultats évoqués suggèrent que les pratiques responsables ne mobilisent pas tous les salariés de la même manière : certains s’y investissent par conviction, d’autres y voient une contrainte ou une formalité. Comment segmenter les collaborateurs selon leur rapport à la RSE (valeurs, motivations, attentes) sans tomber dans une logique de typologie figée ? Peut-on concevoir des dispositifs RSE plus flexibles, proposant plusieurs modalités d’engagement adaptées à la diversité des aspirations (e.g., initiatives bénévoles, projets collectifs, démarches individuelles intégrées au travail quotidien) ?
Un troisième axe de réflexion concerne le rôle des encadrants intermédiaires dans la régulation des dissonances. Si les travaux discutés soulignent l’importance de l’empathie des managers pour atténuer les tensions perçues (Zhang et al., 2025), il reste à interroger les conditions concrètes de mise en œuvre de cette posture dans des environnements contraints par des objectifs de performance ou des injonctions institutionnelles multiples. Quels outils de formation et d’accompagnement pourraient favoriser ce type de posture réflexive chez les managers ? Et dans quelle mesure cette régulation interpersonnelle est-elle suffisante pour compenser un manque de cohérence structurelle dans les politiques RSE ?
Ces questionnements appellent un renouvellement des approches d’évaluation et de pilotage de la RSE. Il ne s’agirait plus uniquement de mesurer les impacts externes des politiques responsables (sociaux, environnementaux, économiques), mais aussi d’interroger leur effet interne sur les dynamiques psychosociales et l’engagement des salariés. Des travaux empiriques restent nécessaires pour analyser comment les construits psychologiques interagissent avec les pratiques RSE sur le terrain, en fonction des contextes sectoriels, des formes d’organisation du travail et des cultures d’entreprise. Il serait également pertinent de mobiliser des méthodologies mixtes (enquêtes, observations, entretiens, expérimentations) pour mieux appréhender les effets différenciés de la RSE sur les trajectoires individuelles et collectives.
Enfin, cette problématisation invite les entreprises à dépasser une conception strictement normative ou communicationnelle de la RSE. En prenant en compte les dimensions psychologiques de l’engagement de leurs salariés, les organisations peuvent non seulement renforcer la robustesse et la cohérence de leurs démarches RSE, mais aussi les inscrire dans une dynamique de co-construction durable.
L’examen des principaux construits psychologiques mobilisés dans le cadre de la RSE – tels que l’adéquation personne-organisation, l’identification sociale, la motivation intrinsèque, le sentiment d’authenticité ou encore la dissonance cognitive – met en évidence la complexité des mécanismes impliqués dans l’adhésion des salariés aux démarches responsables. Loin d’être un simple phénomène d’alignement normatif ou d’acceptation passive des politiques organisationnelles, l’engagement des employés dans la RSE apparaît comme un processus dynamique, ancré dans l’expérience subjective et façonné par l’interaction entre facteurs individuels et contextes organisationnels.
Malgré la présence de recherches présentant l’importance de ces dimensions vis-à-vis de la RSE, leur prise en compte dans la mise en œuvre concrète des politiques RSE demeure encore limitée. Peu d’organisations disposent d’outils leur permettant d’objectiver ces processus ou de prendre en compte la diversité des rapports individuels à la RSE. De plus, la recherche manque également de données empiriques sur la manière dont ces construits se manifestent dans des contextes organisationnels variés, et sur leur articulation avec les facteurs structurels, culturels ou relationnels propres à chaque environnement de travail.
Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer les investigations empiriques à l’interface entre psychologie du travail, management et sociologie des organisations. En particulier, des travaux de terrain combinant méthodes quantitatives (questionnaires, indicateurs d’engagement ou de congruence) et qualitatives permettraient d’éclairer plus finement la manière dont les salariés perçoivent, vivent et interprètent les démarches RSE. Ces recherches offriraient également la possibilité d’identifier les mécanismes de régulation mis en œuvre face aux dissonances perçues, ainsi que les conditions favorables à une appropriation durable des politiques responsables.
En conclusion, l’ancrage organisationnel des politiques de RSE pourrait gagner en efficacité et cohérence lorsqu’il s’accompagne d’une prise en compte explicite des déterminants psychologiques de l’engagement des salariés. L’intégration de ces dimensions, encore peu explorées dans les pratiques organisationnelles, pourrait constituer un axe pertinent pour les politiques RSE des entreprises, à condition d’être articulée à une compréhension contextualisée des dynamiques de celles-ci.
LIRE AUSSI NOTRE ARTICLE :
BIBLIOGRAPHIE
Bustamante, S., Ehlscheidt, R., Pelzeter, A., Deckmann, A., & Freudenberger, F. (2021). The Effect of Values on the Attractiveness of Responsible Employers for Young Job Seekers. Journal of Human Values, 27(1), 27‑48. https://doi.org/10.1177/0971685820973522
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Berlin : Springer Science & Business Media. Https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7.
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
Glavas, A. (2016). Corporate Social Responsibility and Organizational Psychology : An Integrative Review. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00144
Haski-Leventhal, D., Roza, L., & Meijs, L. C. P. M. (2017). Congruence in Corporate Social Responsibility : Connecting the Identity and Behavior of Employers and Employees. Journal of Business Ethics, 143(1), 35‑51. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2793-z
Kristof, A. L. (1996). PERSON‐ORGANIZATION FIT : AN INTEGRATIVE REVIEW OF ITS CONCEPTUALIZATIONS, MEASUREMENT, AND IMPLICATIONS. Personnel Psychology, 49(1), 1‑49. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x
Memon, M. A., Salleh, R., Nordin, S. M., Cheah, J.-H., Ting, H., & Chuah, F. (2018). Person-organisation fit and turnover intention : The mediating role of work engagement. Journal of Management Development, 37(3), 285‑298. https://doi.org/10.1108/JMD-07-2017-0232
Rupp, D. E., Shao, R., Skarlicki, D. P., Paddock, E. L., Kim, T.-Y., & Nadisic, T. (2018). Corporate social responsibility and employee engagement : The moderating role of CSR-specific relative autonomy and individualism. Journal of Organizational Behavior, 39(5), 559‑579. https://doi.org/10.1002/job.2282
Subramanian, S., Billsberry, J., & Barrett, M. (2023). A bibliometric analysis of person-organization fit research : Significant features and contemporary trends. Management Review Quarterly, 73(4), 1971‑1999. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00290-9
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In S. Worchel and W. Austin (Eds), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-48). Pacific Grove, CA/ Brooks/Cole.
Yassin, Y., & Beckmann, M. (2025). CSR and employee outcomes : A systematic literature review. Management Review Quarterly, 75(1), 595‑641. https://doi.org/10.1007/s11301-023-00389-7
Zhang, B., Liu, X., & Zhang, Z. (2025). Warding Off Cognitive Dissonance: How Supervisor Perspective Taking Shapes the Responses of Employees Who Engage in Unethical Behavior. Journal of Business Ethics, 199(1), 71-84.